Analyse
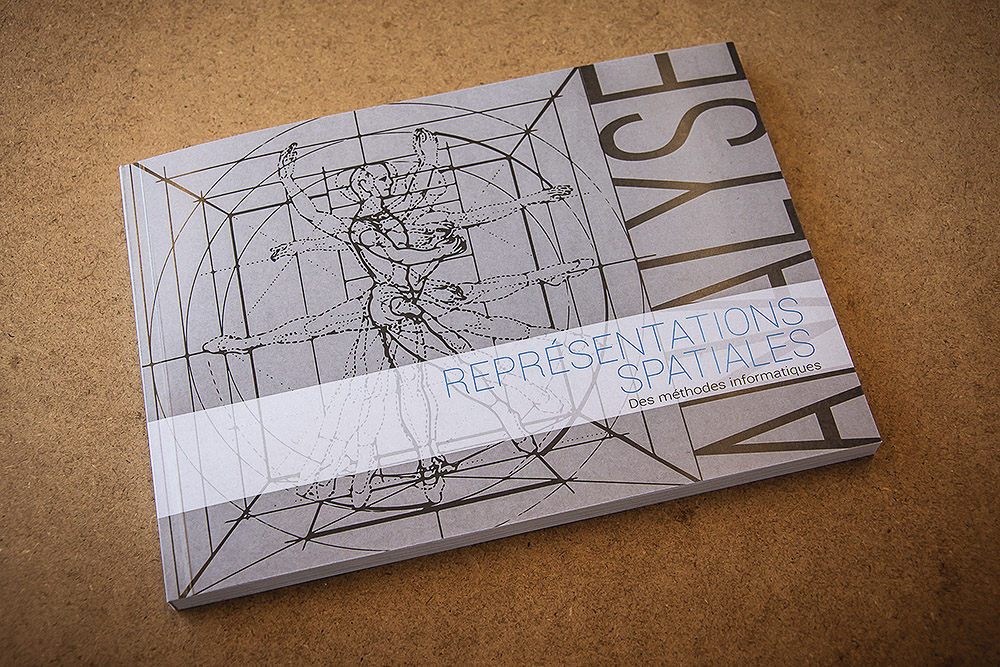
Tout comme notre méthode théorique, nous analyserons ces différentes techniques numériques par une observation, une interprétation et une expérimentation.
Observation
D’où provient la technique étudiée et comment fonctionne-t-elle ?
Interprétation
Ressenti et lecture de l’image produite. Capacité de représentation spatiale et symbolique.
Expérimentation
Possibilités d’utilisation de la technique pour représenter un ouvrage architectural et qualité d’abstraction qu’elle propose.
Afin de présenter un catalogue facile à lire, le contenu de ces différentes étapes d’analyse est réduit à l’essentiel, exprimant une valeur subjective issue de notre propre impression de la technique.
Un premier constat concerne l’informatique numérique en général. La puissance de calcul numérique que nous offre l’informatique est un point crucial dans le développement de techniques déjà existantes de représentation, en particulier la perspective.
Ainsi l’informatique joue un rôle majeur dans la mise en place d’images s’appuyant sur différents modèles mathématiques pour simuler notre perception visuelle d’objets matériels. Le processus de production d’image « ante » et l’isomorphisme nécessaire à sa lecture s’en trouvent largement simplifiés.
Un autre atout de l’informatique réside dans sa gestion numérique des données. Elle permet de réduire, ajouter ou dupliquer des données à la volée (copier/coller) sans destruction de son contenu permettant ainsi de tester des options sans risque de perdre un travail préalablement effectué.
Aussi, cette gestion numérique permet une altération des données par un algorithme choisi donnant ainsi une nouvelle interprétation des données initiales.
Un deuxième constat nous amène à réfléchir sur le changement de médium « papier » au médium « écran ». En effet, un nombre croissant de techniques numériques utilise la fréquence de rafraîchissement de l’écran pour l’affichage d’animations. Ces médias animés apportent une mise en relation d’informations visuelles de manière naturelle au lecteur, du moins dans la période d’activité de sa mémoire à court terme.
Aussi, sur le sujet de la représentation spatiale qui nous intéresse ici, l’animation peut apporter une touche supplémentaire de réalisme afin d’apporter une meilleure immersion dans une représentation « ante » typique de l’architecture.
Nous sommes d’avis que, avec la démocratisation du médium « écran » qui s’accentue chaque année, la représentation en architecte a tout à gagner à s’intéresser aux possibilités d’animer ses espaces. Ainsi naîtront de nouveaux modes de représentation et par là même, nous pouvons le penser, de nouveaux espaces.
Une nouvelle interaction avec la spatialité, ou plus spécifiquement avec sa représentation apparait avec le développement d’outils de modélisation 3D. En effet, le ressenti spatial obtenu dans ces logiciels apporte une interactivité « naturelle » sur une visualisation spatiale qui, en fin de compte, reste en 2 dimensions suivant des règles de perspectives.
De plus, avec une rapidité de calcul des processeurs informatiques s’améliorant d’année en année, le calcul des différents modèles de représentation s’effectue en temps réel permettant une interaction d’autant plus « naturelle » avec les éléments que nous manipulons.